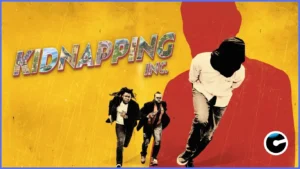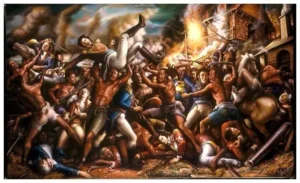Alors que les États-Unis accentuent la pression pour une OEA plus responsable, une tension palpable semble émerger entre le Secrétaire général sortant, Luis Almagro, et son successeur désigné par acclamation, Albert Ramdin, autour du dossier haïtien. Un symposium inattendu lancé par Almagro à quelques jours de la fin de son mandat soulève des interrogations, tandis que la représentation haïtienne elle-même affiche des divergences notables.
Le 10 mars 2025, un coup de théâtre a marqué l’élection du nouveau Secrétaire général de l’Organisation des États Américains (OEA). Le retrait surprise de Rubén Ramírez Lezcano, ministre des Affaires étrangères du Paraguay, a ouvert la voie à une désignation par acclamation d’Albert Ramdin. Selon des sources généralement crédibles, Ramdin aurait souhaité attendre son installation officielle le 26 mai 2025 pour se prononcer sur la crise haïtienne, un dossier dont l’urgence ne cesse de s’accroître.
C’est dans ce contexte que Luis Almagro, à quelques jours seulement de la fin de son mandat, a lancé un symposium sur la situation en Haïti. Cette initiative, si elle peut être perçue comme une tentative de montrer que l’OEA n’est pas restée inactive, soulève néanmoins des questions. Certains observateurs se demandent si elle ne vise pas à influencer la future administration, d’autant plus que l’OEA est critiquée pour n’avoir, de l’avis général, rien n’est fait de substantiel pour sortir le pays de son marasme croissant. Est-ce une manière de laisser une empreinte durable ou de “nettoyer” l’image d’une organisation qui n’a pas su, ou voulu, agir efficacement jusqu’à présent ?
La représentation haïtienne à ce symposium a, elle aussi, été source de confusion et de malaise. Le ministre de la Défense, Jean-Michel Moïse, a choisi de faire sa présentation en anglais – une décision surprenante pour un pays francophone – et a avancé, noir sur blanc, que Haïti était un problème pour l’hémisphère. Une déclaration qui contraste vivement avec l’allocution du conseiller présidentiel, qui a clairement rejeté l’idée de faire passer l’île pour un danger régional.
Cette discorde au sein même de la délégation haïtienne interroge la cohérence et l’efficacité de la stratégie du pouvoir en place. En l’absence de tout plan concret présentant des pistes de solutions et des potentiels appuis souhaités, la représentation haïtienne s’est contentée de dresser un sombre tableau d e la situation. N’est-ce pas là une invitation tacite à la communauté internationale à prendre, une fois de plus, des décisions qui ne conviennent pas au pays, à l’instar du récent et inédit pouvoir à “neuf présidents” qui n’a fait qu’aggraver la confusion ?
La pression américaine pour une OEA plus proactive et responsable sur le dossier haïtien est indéniable. Mais la “guerre froide” qui semble poindre entre Almagro et Ramdin, couplée à une représentation haïtienne aux abonnés absents en termes de propositions concrètes, risque de reléguer Haïti au rang de terrain de jeu politique et diplomatique, au détriment de ses besoins urgents et cruciaux.
L’absence du prochain secrétaire General de l’OEA au Symposium sur la crise sécuritaire en Haïti jeudi au bureau de l’organisation hémisphérique à Washington soulève de nombreuses interrogations sur l’avenir du CPT. Albert Ramdin semble s’aligner sur la position américaine qui demande au Gouvernement d’Haïti de plus pour rendre possibles le référendum et les élections dans le Pays. Le Diplomate surinamien qui devrait rentrer en fonction le lundi 26 mai 2025 devrait soumettre une nouvelle feuille de route sur la crise haïtienne aux partenaires régionaux. Est-ce qu’une nouvelle transition pourrait émerger de ce plan ? Rien n’est sûr.
L’OEA est à un carrefour : saura-t-elle enfin dépasser les jeux de pouvoir pour apporter des solutions viables à la crise haïtienne, ou se contentera-t-elle de regarder le pays s’enfoncer davantage ? L’installation de Ramdin le 26 mai 2025 sera un moment clé pour observer les premières orientations de la nouvelle administration face à ce défi majeur.
La Rédaction